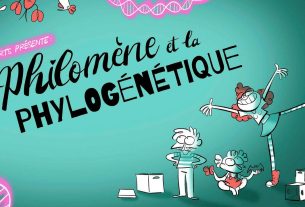Colocation pour seniors : entre solitude et vie en communauté en Suisse romande
À Lausanne, dans l’appartement collectif de la coopérative L’Utopie, sur les Plaines du Loup, quatre générations échangent sur leurs visions de la vie communautaire et sur l’évolution de ce mode d’habitat.
Les années 70 : une vie en communauté inspirée par l’action collective
Geneviève avait 20 ans en 1966 lorsqu’elle s’est mariée et était mère à cet âge, avant une séparation à 24 ans. Dans les années 70, elle rejoint une communauté à Pully avec sa fille en bas âge, motivée par le désir d’autre chose que le cadre familial traditionnel : « J’avais envie qu’elle ne soit pas qu’avec sa maman. J’avais envie qu’on vive autre chose. »
Quatre adultes, dont trois jeunes mamans et leurs enfants, partageaient alors une grande maison. Le fonctionnement était simple : chacun cuisine un jour par semaine, le ménage était collectif le lundi et les décisions se prenaient ensemble. « Globalement, on fait tous pareil. Et puis celui qui n’a pas envie, il s’en va », résume le témoignage.
Le modèle financier était radical : un prix unique pour tous. Lorsqu’un jeune arrivait sans moyens, on n’exerçait pas de pression : « Tant que tu es à l’aise de ne pas payer, tu ne paies pas mais quand tu pourras payer, tu payeras. » Trois mois après son arrivée, la jeune personne a fini par payer comme les autres, selon sa conscience.
La communication, c’est la clé dans une colocation — Maha, 22 ans
La colocation : entre idéal et réalité
Maha, 22 ans, a quitté le domicile familial à 17 ans et demi pour une colocation à six. L’expérience n’a pas été idéale : elle ne connaissait pas les colocataires et n’osait pas dire ce qui la dérangeait, se sentant comme une intruse.
Aujourd’hui en colocation à deux, elle identifie l’enjeu central : la communication. « Dans la colocation, la communication, c’est la clé. Quand elle ne fonctionne pas, cela crée des tensions. » Son exemple : une colocataire exprime son mécontentement en faisant la vaisselle bruyamment plutôt qu’en parlant.
La colocation intergénérationnelle : un concept qui se structure
En 2019, Kevin lance une plateforme de colocation intergénérationnelle dans le cadre de son master en travail social. Le concept est répandu en France et en Allemagne, mais peine au début à s’implanter en Suisse romande. Son approche privilégie un accompagnement social complet : on pose des questions concrètes aux seniors qui disposent d’espace chez eux. Est-ce que le jeune qui vient peut inviter quelqu’un à dormir ? Comment imaginez-vous la cohabitation ?
Une anecdote illustre l’importance de ce cadrage : une senior accepte qu’une jeune femme invite la personne qu’elle aime à dormir, mais la réaction devient violente lorsque la convive apparaît comme une amie et non comme une compagne : la jeune est renvoyée. Cette discrimination a été difficile à vivre pour tous. Aujourd’hui, Kevin a instauré un système de chambres d’urgence pour gérer ce type de situations. L’accompagnement se poursuit sur le long terme, avec des visites régulières pour vérifier que chacun se sent à l’aise.
La coopérative, c’était le meilleur projet que j’avais pour vieillir — Geneviève, 79 ans
Contrairement à certaines idées reçues, plus de la moitié des seniors accueillent des jeunes pour des raisons financières plutôt que par solitude.
À 65 ans, créer des appartements protégés
Willy, 90 ans, observe ces dynamiques avec recul : la colocation peut être bénéfique pour les jeunes, mais devenir plus délicate avec l’âge. Son histoire illustre une autre voie : après une carrière dans le négoce international, il prend sa retraite et voit sa mère, EMS depuis dix ans, rencontrer des difficultés. Il fonde une organisation et obtient un droit de superficie de la Ville de Lausanne. Huit maisons et 61 appartements protégés accessibles dès 55 ans y sont construits. Willy vit désormais dans l’un d’eux, pensé pour limiter les obstacles : douche à l’italienne, pas de seuils, portes élargies, mais sans médicalisation. Dans ce petit ensemble des hauteurs lausannoises, les activités collectives — gym, sophrologie, cours de philosophie — rythment le quotidien et visent à rompre avec la solitude tout en préservant l’autonomie.
Un parcours d’attente de 15 ans pour le bon projet
Au début de sa vie, Geneviève a connu l’expérience de la vie en communauté; aujourd’hui, plus âgée, elle rejoint la coopérative L’Utopie après quinze ans d’attente. « Je me suis dit : si je ne fais pas cela, qu’est-ce que je pourrais mieux faire ? C’était le meilleur projet pour vieillir », raconte-t-elle. Dans l’immeuble, elle connaît ses voisins et entretient des liens solides — « À mon étage, il y a une amie que je connais depuis 50 ans ». Elle anime un atelier de peinture chaque dimanche pour adultes et enfants : « C’est la grâce. Voir ces jeunes créer et s’amuser me comble. » Une anecdote marquante : un samedi soir, des voisins font la fête; elle ouvre sa fenêtre à minuit et demi pour demander, simplement, de parler un peu moins fort. Depuis, les échanges se font avec des gestes de coucou.
Luigi Marra / RTS